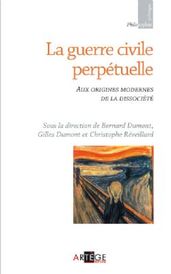[note : cet article a été publié dans catholica, n. 28, p. 34–38].
Le recul catastrophique de l’Eglise dans la vie de la cité semble donner raison aux penseurs du laïcisme qui célèbrent actuellement une victoire à laquelle, en réalité, ils n’ont jamais cru. Les arguments qu’ont accumulés pendant des siècles libertins, libres penseurs, philosophes des Lumières, libéraux et socialistes, portent à un point qu’une partie influente du clergé lui-même les reprend, sans parler des intellectuels, des publicistes et des professeurs qui se voient justifiés, et contents. Désormais il est inutile de combattre l’ennemi et d’écraser l’Infâme, l’histoire elle-même s’en est chargée. Les institutions-monstres disparaissent l’une après l’autre, nous dit-on : le nazisme, le communisme soviétique, les despotes du tiers monde, et l’Eglise s’affaiblit elle aussi. Ce n’est pas encore la disparition ou l’absorption, disons dans la franc-maçonnerie, mais c’est déjà le statut accepté d’un groupe de pression, d’un lobby. L’Eglise n’a pas davantage d’autorité, et nombreux sont les plaisantins qui la comparent à une entreprise-géante, comme par exemple IBM, qui vendrait, au lieu de parapluies ou d’ordinateurs, la foi et ses instruments réputés sacrés. La persécution de l’Eglise dans le passé se déroulait sur deux fronts : l’un était celui des princes cruels ou appartenant à d’autres religions, de Néron aux shoguns japonais ; l’autre front était interne, notamment les hérésies dont les aspirations aboutissent de nos jours à priver l’Eglise de ses mécanismes protecteurs, de son armature institutionnelle. Aussi l’Eglise aujourd’hui n’a‑t-elle plus qu’un seul front où se battre : le modernisme, dont le message a toujours été identique à travers les siècles : inutile d’avoir une religion — mécanisme consolateur contre le malheur — quand la société est devenue parfaite. Ne sommes-nous pas d’heureux consommateurs de biens, d’avortement et de sexe, n’avons-nous pas les droits de l’homme, l’égalité et les experts qui surveillent notre bien-être ? Tant que deux régimes et deux superpuissances se partageaient la planète, le débat sur le système idéal était permis ; en cette fin de siècle, inutile de discuter, l’histoire a tranché. L’encyclique ne serait valable qu’en tant qu’elle souscrit à la thèse triomphante, capitaliste, laïque, pluraliste.
Le plus grave dans cette affaire n’est pas l’attaque, souvent ironique et irrespectueuse, contre telle encyclique ou tel document émanant de Rome. C’est qu’après deux mille ans de christianisme les hauts lieux soient de nouveau occupés par les analphabètes religieux. Imaginons qu’au lieu de le mener à l’exécution, les geôliers de saint Paul l’aient conduit chez Néron lui-même, entouré d’Agrippine, de Poppée, mais en l’absence de Sénèque, tombé en disgrâce. L’Apôtre aurait eu à peu près la même chance d’être compris dans la Domus Aurea que son lointain successeur dans les tables rondes télévisées en 1991. L’empereur lui aurait dit de ne pas déranger sa politique impériale, les experts du moment enjoignent à Jean-Paul II de se tenir à l’écart de leur spécialité, l’économie. En deux millénaires on n’a au fond rien appris — et rien oublié. Il n’est pas inutile, dans ces conditions, d’élucider l’arrière-plan philosophique dans laquelle Centesimus annus a vu le jour et doit faire face à ses critiques.
Choisissons comme guide l’érudit italien Ernesto Buonaiuti, mort il y a une trentaine d’années et controversé toute sa vie de professeur. Entre autres activités, il donna une demi-douzaine de conférences devant l’association Eranos, mise sur pied par le psychologue C. G. Jung et ses associés, à Ascona, en Suisse. Les communications d’Eranos sont encore aujourd’hui de la plus haute qualité, élucidant les problèmes historiques et doctrinaux de la religion, du mythe, de la psychologie, de l’anthropologie, voire de la biologie et de la science. Buonaiuti lui-même y faisait ses communications au milieu des années trente, puis en 1940 et 1941. Ce qui est remarquable chez lui, c’est que, étant catholique, il accepta sa marginalisation par rapport à l’esprit de l’époque qui soufflait du côté de l’orthodoxie romaine. La thèse de Buonaiuti n’est pas originale, et sa signification n’est accentuée ici que pour montrer l’inanité et la superficialité des « théologiens du capitalisme », conglomérat nord-américain face aux « théologiens de la libération » qui sont chez eux en Amérique du Sud — les uns et les autres sans fondement doctrinal et sans connaissances historiques. Que dit Ernesto Buonaiuti qui devient tout à coup sympathique lorsqu’on le compare aux triomphateurs éphémères convaincus aux Etats-Unis que l’histoire est close, notamment avec la victoire de leur idéologie ? Que l’immense nouveauté prêchée par le Christ est une religion de conversion, face aux religions antérieures, toutes d’initiation magique.
Le Christ, bien qu’il ne soit pas sorti du cadre judaïque selon notre érudit (position évidemment très contestable), enseigna la re-naissance de l’âme, une foi toute en intériorité, la sortie du matériel, l’orientation entièrement spirituelle. Or, les disciples ne l’entendirent pas de cette oreille, surtout Pierre (que Buonaiuti appelle prudemment Céphas, son nom hébraïque), et ils cherchèrent à construire une institution qui survivrait aux premières années tumultueuses de la secte chrétienne, accablée par le judaïsme d’un côté, par la paganitas gréco-romaine de l’autre. Ici, notre Italien se montre plus radical que François d’Assise ou Joachim de Flore, parce qu’il pense que l’organisation, presque dès le début, écrasa l’inspiration christique/charismatique, et que l’Eglise ne figurait ni dans la pensée du Christ ni dans celle de Paul. C’était un pis-aller, celui de l’esprit ossifié, discipliné, bureaucratisé. La seule différence entre le Christ et Paul est que ce dernier a étendu la nouvelle foi à tous les hommes dont il voulait transformer les impulsions égoïstes et limitées en l’amour dans le Christ, une sublimation surnaturelle. C’est que le moi, sans cette transformation, est haïssable tandis que le même sang spirituel circulant dans le corps social crée le corps mystique. L’opposition corps et âme cesse, l’esprit de la liberté ne reconnaît que le corps du Christ dont nous sommes tous membres. Ce corps est toujours en formation sans jamais être formé, de sorte que l’Eglise elle-même reste ce viator, ce pèlerin qui ne peut pas dire qu’elle aboutit, qu’elle est plénière, méritante, triomphante. Cette Eglise spirituelle (ecclesia spiritualis, dit Buonaiuti) est comme Abel face à Caïn, l’éternel voyageur face au pécheur qui cherche la stabilité et construit la Ville/institution pour s’y cacher contre l’ire de Dieu. La Ville/institution, de son côté, sert d’abri aux timides, aux pédants, aux systématiques qui pensent acheter la rédemption à l’aide de quelques formules et quelques actions prescrites. Voilà, on l’a reconnu, le règne de Céphas, l’Eglise romaine. L’excès de Buonaiuti n’est pas à démontrer, c’est, à son tour, la formule des « idéalistes » et des « enthousiastes » qui ne voient pas le corps mais seulement l’âme, et qui, dans leur innocence, sont prêts à ravager et la terre et le ciel, les âmes ainsi que les corps. Pol Pot lui aussi fut à la recherche de « communistes purs » et massacra trois millions de ses concitoyens. Saint Augustin et saint Thomas écrivent eux-mêmes qu’une société parfaitement juste étant impossible sur cette terre, on ne réalise que des approximations, et encore.
Cependant, il y a un grain de vérité dans ce que pense Ernesto Buonaiuti. L’Eglise consiste en effet en deux traditions, à jamais opposées, à jamais en dialogue. L’Eglise n’appartient pas à César, mais les fidèles, en tant que citoyens, paient leurs oboles comme le Christ l’a commandé. A chaque instant, il y a enchevêtrement entre ce que le savant Italien veut distinguer, ce qui est bien, mais aussi dissocier, ce qui est à condamner. Le miracle est qu’en dépit de tout, l’Eglise ne marche pas sur une corde raide, elle se trouve à l’aise dans les deux mondes qu’elle parvient presque à réunir, de temps en temps. C’est son réalisme transcendant qu’il convient de ne pas perdre de vue.
Je ne sais si c’est une preuve contre Buonaiuti, mais si Dieu a voulu que l’Eglise fût plongée dans le milieu gréco-romain, il n’a pas envisagé qu’elle le fût sans les instruments nécessaires pour l’existence terrestre, je veux dire les institutions qui maintiennent, cahin-caha, une communauté humaine, lui assurant la survie et l’unité doctrinale. Les plus grands penseurs de l’Antiquité, d’Aristote aux Stoïques et à Cicéron, élaboraient les modalités de la Cité, que ce soit la polis, l’empire romain, voire la communauté humaine universelle qu’envisagent Sénèque et Marc-Aurèle. Créer une Eglise éphémère ne pouvait pas être l’objectif des fondateurs du christianisme, et Buonaiuti se trompe lorsqu’il suppose que fonder l’Eglise était un pis-aller de la part de la seconde ou troisième génération devant l’absence obstinée de la parousie. Ces fondateurs étaient assez réalistes — c’étaient des juifs — pour savoir que le jugement dernier n’était pas pour le lendemain, et encore moins la métanoia, la conversion de tous aux valeurs spirituelles. Ce qui nous intéresse surtout, tenant compte de Centesimus annus et des controverses qu’elle suscite, c’est la réalité des deux traditions auxquelles l’Eglise tient absolument, sans laisser se relâcher l’une ou l’autre. Les partisans du capitalisme, forts de ce qu’ils pensent être la victoire finale de leur cause (comme dans l’Internationale prolétarienne, il y a encore une ou deux décennies), reprochent à Jean-Paul II son « socialisme ». En Amérique, certains milieux parmi les plus influents l’ont même appelé « le dernier socialiste ». Inutile de dire que c’est faux. L’Eglise a collaboré dès le début à la création et à la bonne marche de la Cité terrestre, non pas dans le sens augustinien, mais historiquement, lorsqu’il s’agissait d’assurer la transition de l’empire romain aux royaumes barbares. En même temps, cependant, l’Eglise garde en son cœur et parmi ses préoccupations le noyau de l’ecclesia spiritualis à laquelle elle ne pourrait renoncer sans se renier.
Buonaiuti se trompe lorsqu’il fait trop pencher la balance dans une direction, méprisant l’autre. L’Eglise, elle, représente l’équilibre. Voilà la raison qui interdit au pape de renoncer à l’idée socialiste. Le socialisme marxiste est à rejeter, mais au fond pas parce que c’est le socialisme, mais du fait qu’il se constitue en un Etat/parti totalitaire, enlevant ainsi aux hommes la possibilité de se défendre contre l’exploitation économique. En outre, mais les critiques de l’encyclique ne portent pas sur ce point, la notion socialiste reflète, même obscurément, ce noyau mystique dont parle le savant Italien. Une des « traductions » terrestres du corps mystique du Christ restera, peut-être d’une façon permanente, l’idée socialiste. L’espoir ne s’éteindra jamais de voir dans l’assemblée des pauvres, des marginaux, des laissés-pour-compte, des esprits simples la figure lumineuse du Christ. Ce n’est pas le langage, tant s’en faut, des réalités économiques, et on n’a pas de difficulté à démontrer, ordinateur sous la main, que la « richesse des nations » (concept d’Adam Smith) ne passe pas par la ligne imaginaire de la dialectique riche/pauvre, propriétaire/salarié, actionnaire/ouvrier. L’idée sociale aura toujours sa place dans la doctrine et dans l’enseignement catholiques — ce qui permettra à des gens comme Ernesto Buonaiuti de tirer la couverture à eux — tandis qu’en face on aura la même ambition. La vérité catholique se trouve par conséquent des deux côtés, comme bien souvent. Ce que les Buonaiuti et leurs prédécesseurs, l’Abbé Joachim, ensuite les Fraticelli (gauche franciscaine) n’apprécient pas est que si l’Eglise n’était pas institutionnelle (ils diraient charnelle, mondaine), les autres institutions : l’Etat, la société civile, la concurrence économique, écraseraient l’individu et le groupe, la famille et les moines. Une assemblée de marginaux à la place de ce que nous appelons Eglise serait vite liquidée par les appétits environnants, les passions, la mauvaise volonté. D’où les commandements de Jésus : reconnaissez, dit-il à ses fidèles, votre appartenance partielle à la société des hommes et ses institutions et lois ; pais mon troupeau, dit-il à Céphas.
D’un autre côté, l’Eglise a régulièrement été critiquée, et cela bien plus radicalement, par les représentants d’autres religions comme l’Islam, les bouddhistes, etc. Un érudit islamologue comme Henry Corbin voit dans l’engagement du Christ, puis de saint Paul, une ouverture dangereuse au monde, impossible à freiner et qui sert de prétexte à la sécularisation croissante des peuples chrétiens. Le problème tourne autour de l’Incarnation qui, primo, abolit la distance entre l’homme et la divinité, abolissant en même temps la vigueur et la potentialité des médiateurs quasi indépendants (ce n’est pas le cas des saints) ; et, secundo, fait pencher la balance (il s’agit toujours du Christ incarné) en direction du côté humain de Dieu, par conséquent de la raison de préférence à la foi, etc. Vu par Corbin ou par Buonaiuti, le christianisme implante la dualité ; vu par les païens, il met un terme à la multiplicité foisonnante du polythéisme ; vu par les critiques actuels de l’encyclique Centesimus annus, Rome maintient le dualisme Dieu/homme au lieu de se ranger, une fois pour toutes, auprès du monisme de l’homme seul. Le marxisme n’a pas dit autre chose : faites-nous des conditions édéniques sur terre en organisant et distribuant les ressources, et nous éliminons Dieu et la religion de l’univers mental de l’humanité. Observons entre parenthèses que les marxistes qui se disaient les vrais humanistes, un E. Bloch, un G. Lukacs, s’intéressaient au problème économique uniquement comme à la voie royale vers un état de choses où le travail deviendrait une partie minime de la journée, le reste du temps et de la vie étant consacré à l’épanouissement culturel. Mutatis mutandis, les capitalistes modernes sont du même avis, le conflit entre eux et les marxistes ne porte que sur les méthodes : comment organiser les modalités de la production/distribution en vue d’abolir le travail (les machines sont là pour se substituer aux hommes) et d’universaliser la culture. Bref, l’encyclique ne pouvait, ab ovo, contenter tous ses lecteurs car elle reste l’expression d’une vision du monde au carrefour de nombreuses tendances de la pensée pré-chrétienne et moderne. Sa fonction est de réaffirmer des vérités et d’écarter les extrêmes. Non seulement du capitalisme et du socialisme, mais également ceux des divers monistes, manichéens et anti-incarnationnistes. La voie est étroite mais ne devient jamais un cul-de-sac.
Rubrique(s) : Revue en ligne, Textes