Liturgie. L’espace retourné
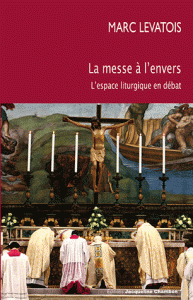
Le livre de Marc Levatois se termine par l’exposé de la pensée du cardinal Ratzinger sur l’espace sacré, et en faisant état de la proposition de celui-ci de placer la croix sur l’autel même afin de centrer l’attention tant du prêtre que de l’assemblée sur le Seigneur, la personne du prêtre n’étant en aucun cas le centre de l’attention, et réservant les moments de focalisation sur l’ambon à la « liturgie de la parole ».
Il est indéniable que cet autel « face au peuple », aussi précaire que semble le bois (ou l’aggloméré) dont très souvent il est fait, aura été la pierre angulaire du grand chambardement, sans qu’il fût besoin de la moindre précision normative, ni, dans les éditions successives du nouveau missel, d’une quelconque mention, jusqu’à ce que, crainte sans doute de la contamination du rite proclamé « ordinaire » par un rite « extraordinaire » regagnant un peu vite en faveur, une plus récente édition vienne in extremis officialiser l’état de fait, quitte à lui accorder une certaine préférence, formalité dont on ne s’embarrassa point aussi longtemps que la victoire de « l’autel face au peuple », en dédain complet de toute norme, victoire brutale du fait clérical conjoint au fait de la mode, et qui n’eut d’égale en subversion que celle de l’improbable, irréaliste et faussement primitive « communion dans la main », fut tenue pour aussi absolue et définitive que l’écrasement du rite dit tridentin.
Ce retournement de l’autel aura été, aux côtés de la supplantation indiscernée du latin par le vernaculaire, de ce qu’a pu inspirer le fameux et pourtant bien méconnu « mouvement liturgique » (lequel avait recherché, expérimenté en évitant de légiférer), une des systématisations les plus funestes. Faudra-t-il en conclure que du mouvement liturgique la réforme, et plus encore les applications incontrôlées de la réforme, ont gardé surtout le plus contestable ?
Perplexités qui avaient été celles de ces précurseurs préconisant, tantôt que les signes sacrés reprennent de la vigueur, tantôt qu’ils redeviennent accessibles. Mais s’agissait-il dans leur esprit de rendre le don de Dieu acceptable aux gens ? N’était-ce pas plutôt de les faire accéder à Dieu par le chemin qu’Il nous offre Lui-même à cet effet, et qui n’est autre que celui du sacré ? Louis Bouyer, d’un volume à l’autre de son œuvre, a démontré que, loin d’être une histoire de la prédominance du sacré, l’histoire préchrétienne est à bien des égards celle de sa déperdition. Supprimer le sacré serait tellement peu passer d’une mentalité païenne à une pureté chrétienne qu’une telle opération reviendrait en réalité à se priver, ni plus ni moins, du moyen même par lequel Dieu a voulu de tout temps se faire connaître, moyen que la Rédemption n’a pas rendu caduc mais haussé à ses véritables possibilités.
Une question fondamentale, évoquée communément par le clivage en fausse symétrie entre droite et gauche, reste celle de l’accueil ou du rejet par notre monde de l’autorité qui est liée à la vérité. Sans aplatir le problème aux perspectives (même si elles ont leur légitimité propre) d’un traditionalisme politico-religieux, on ne peut sans légèreté ignorer combien la question de l’espace sacré rejoint celle de l’institution familiale, de l’habitat, de l’économique et du politique, des hiérarchies sociales conçues distinctement mais non séparément de la hiérarchie ecclésiale.
Sous un débat qui aux yeux du monde actuel apparaît de cuisine domestique et tout cantonné à la réserve des Mohicans que lui semblent souvent devenus les catholiques, se cachent des questions qui touchent à la dignité de l’homme, au sens de la vie, à la véritable morale, à la justice, au bonheur. Il s’agit de rien de moins que de la place reconnue concrètement par l’humanité à son Sauveur et des conséquences décisives qui dépendent dramatiquement de la mesure de cette reconnaissance.
Concédons que cela n’a pas été pas totalement ignoré, puisque, selon la lettre de Vatican II, la liturgie (eucharistique) est explicitement conçue comme source et sommet de l’existence chrétienne. Mais il ne semble pas que cette grande vérité ait été entendue avec les implications voulues. On s’est enchanté de l’idée, sans guère la mettre en œuvre, faute d’en comprendre la portée spirituelle et surtout d’en accueillir la conséquence abrupte en théologie de la grâce, parti qu’on était à la dérive d’une mentalité résolument pélagienne (psychologisante, moralisante, activiste), fasciné qu’on était par les sirènes d’un monophysisme utopique (ne considérer que la nature humaine en Jésus et que la dimension sociopolitique de l’Eglise et psychologique du sujet humain).
Il est significatif que le retournement de l’autel se soit imposé sans coup férir (à vrai dire en grande partie parce que l’opération, dans le style Blitzkrieg, fut un fameux coup d’assommoir, du genre de ceux qui servent d’anesthésie avant l’abattage), avec une bizarre unanimité, sans qu’il y eût besoin de légiférer en aucune manière. Un consensus aussi unique dans l’histoire de la chrétienté trahit, en deçà comme au-delà de la lettre des textes conciliaires et de ceux qui découlent d’eux, un esprit, dont on ne voit décidément pas comment le dissocier de celui même qui fut à l’œuvre au Concile, disons plutôt – à la fois pour rester précis et pour laisser ouverte la réflexion – de l’un des divers esprits qui s’affrontèrent ou s’allièrent dans l’aula conciliaire.
Ce bouleversement de l’espace sacré, et plus généralement la désacralisation de l’espace en général, est un phénomène post-chrétien. La perte des signes sacrés dans l’espace public a accompagné de près la perte des points de repère éthiques et métaphysiques, et le monde catholique n’a rien réussi d’autre ici, somme toute, que de suivre la pente commune et savonnée de la facilité, avec ce crâne parti pris pour le fait accompli à quoi tient tout le succès des révolutions. Son excuse est sans doute d’avoir voulu manifester par des changements sensationnels une réalité ecclésiale fraternelle et dynamique que la théologie jusque là était censée (voulait-on croire) avoir plus ou moins occultée, une réalité telle que tendait à l’exprimer selon le goût du jour le slogan désormais consacré, non sans un mimétisme plus ou moins inconscient par rapport à des utopies pourtant déjà bien en perte de vitesse, de « peuple de Dieu », régressant ainsi vers ce qu’a encore d’inaccompli (si l’on met à part la prophétie) une vision vétérotestamentaire de l’Alliance, et détournant ainsi l’intelligence chrétienne d’une vision de l’Eglise comme Corps mystique d’une part, comme Epouse et Mère d’autre part. En résumé, morne chute dans le sociologique, qui se traduisit dès lors un peu partout et pour longtemps dans une liturgie anémiée et boursouflée à la fois.
Une des marques les plus affligeantes de cette situation se trouve dans le dédoublement de l’autel, à savoir une table plus ou moins banale, évoquant dans plus d’un cas une table de conférences, un peu surélevée sur un prosaïque podium et placée devant et sous un maître-autel désaffecté réduit à servir de décor, inévitablement plus ou moins somptueux, sur lequel, comme signe involontaire mais combien éloquent du malheur des temps, n’est plus offert le saint Sacrifice , au profit de la notion réputée plus « porteuse » et plus adaptée de « repas » (ou de synaxe, le grec triomphant enfin du latin), mais d’un repas qui n’est à aucun moment présenté comme repas essentiellement sacrificiel – la réalité sacrale de repas, comme d’ailleurs celle de fête sacrée, étant de tout temps ce qu’on avait oublié ou n’avait jamais su, identique à celle de sacrifice –, mais très platement dans la perception obvie et profane d’un repas convivial, censément « festif », autrement dit gai et ennuyeux à souhait, où le mystère de la propitiation opérée par le Rédempteur chargé du péché du monde et rendant tout honneur et tout amour au Père ne pouvait, quoi qu’on en dise, que passer à l’arrière-plan.







