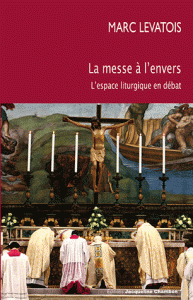
Le livre de Marc Levatois se termine par l’exposé de la pensée du cardinal Ratzinger sur l’espace sacré, et en faisant état de la proposition de celui-ci de placer la croix sur l’autel même afin de centrer l’attention tant du prêtre que de l’assemblée sur le Seigneur, la personne du prêtre n’étant en aucun cas le centre de l’attention, et réservant les moments de focalisation sur l’ambon à la « liturgie de la parole ».
Il est indéniable que cet autel « face au peuple », aussi précaire que semble le bois (ou l’aggloméré) dont très souvent il est fait, aura été la pierre angulaire du grand chambardement, sans qu’il fût besoin de la moindre précision normative, ni, dans les éditions successives du nouveau missel, d’une quelconque mention, jusqu’à ce que, crainte sans doute de la contamination du rite proclamé « ordinaire » par un rite « extraordinaire » regagnant un peu vite en faveur, une plus récente édition vienne in extremis officialiser l’état de fait, quitte à lui accorder une certaine préférence, formalité dont on ne s’embarrassa point aussi longtemps que la victoire de « l’autel face au peuple », en dédain complet de toute norme, victoire brutale du fait clérical conjoint au fait de la mode, et qui n’eut d’égale en subversion que celle de l’improbable, irréaliste et faussement primitive « communion dans la main », fut tenue pour aussi absolue et définitive que l’écrasement du rite dit tridentin.
Ce retournement de l’autel aura été, aux côtés de la supplantation indiscernée du latin par le vernaculaire, de ce qu’a pu inspirer le fameux et pourtant bien méconnu « mouvement liturgique » (lequel avait recherché, expérimenté en évitant de légiférer), une des systématisations les plus funestes. Faudra-t-il en conclure que du mouvement liturgique la réforme, et plus encore les applications incontrôlées de la réforme, ont gardé surtout le plus contestable ?
Perplexités qui avaient été celles de ces précurseurs préconisant, tantôt que les signes sacrés reprennent de la vigueur, tantôt qu’ils redeviennent accessibles. Mais s’agissait-il dans leur esprit de rendre le don de Dieu acceptable aux gens ? N’était-ce pas plutôt de les faire accéder à Dieu par le chemin qu’Il nous offre Lui-même à cet effet, et qui n’est autre que celui du sacré ? Louis Bouyer, d’un volume à l’autre de son œuvre, a démontré que, loin d’être une histoire de la prédominance du sacré, l’histoire préchrétienne est à bien des égards celle de sa déperdition. Supprimer le sacré serait tellement peu passer d’une mentalité païenne à une pureté chrétienne qu’une telle opération reviendrait en réalité à se priver, ni plus ni moins, du moyen même par lequel Dieu a voulu de tout temps se faire connaître, moyen que la Rédemption n’a pas rendu caduc mais haussé à ses véritables possibilités.
Une question fondamentale, évoquée communément par le clivage en fausse symétrie entre droite et gauche, reste celle de l’accueil ou du rejet par notre monde de l’autorité qui est liée à la vérité. Sans aplatir le problème aux perspectives (même si elles ont leur légitimité propre) d’un traditionalisme politico-religieux, on ne peut sans légèreté ignorer combien la question de l’espace sacré rejoint celle de l’institution familiale, de l’habitat, de l’économique et du politique, des hiérarchies sociales conçues distinctement mais non séparément de la hiérarchie ecclésiale.
Sous un débat qui aux yeux du monde actuel apparaît de cuisine domestique et tout cantonné à la réserve des Mohicans que lui semblent souvent devenus les catholiques, se cachent des questions qui touchent à la dignité de l’homme, au sens de la vie, à la véritable morale, à la justice, au bonheur. Il s’agit de rien de moins que de la place reconnue concrètement par l’humanité à son Sauveur et des conséquences décisives qui dépendent dramatiquement de la mesure de cette reconnaissance.
Concédons que cela n’a pas été pas totalement ignoré, puisque, selon la lettre de Vatican II, la liturgie (eucharistique) est explicitement conçue comme source et sommet de l’existence chrétienne. Mais il ne semble pas que cette grande vérité ait été entendue avec les implications voulues. On s’est enchanté de l’idée, sans guère la mettre en œuvre, faute d’en comprendre la portée spirituelle et surtout d’en accueillir la conséquence abrupte en théologie de la grâce, parti qu’on était à la dérive d’une mentalité résolument pélagienne (psychologisante, moralisante, activiste), fasciné qu’on était par les sirènes d’un monophysisme utopique (ne considérer que la nature humaine en Jésus et que la dimension sociopolitique de l’Eglise et psychologique du sujet humain).
Il est significatif que le retournement de l’autel se soit imposé sans coup férir (à vrai dire en grande partie parce que l’opération, dans le style Blitzkrieg, fut un fameux coup d’assommoir, du genre de ceux qui servent d’anesthésie avant l’abattage), avec une bizarre unanimité, sans qu’il y eût besoin de légiférer en aucune manière. Un consensus aussi unique dans l’histoire de la chrétienté trahit, en deçà comme au-delà de la lettre des textes conciliaires et de ceux qui découlent d’eux, un esprit, dont on ne voit décidément pas comment le dissocier de celui même qui fut à l’œuvre au Concile, disons plutôt – à la fois pour rester précis et pour laisser ouverte la réflexion – de l’un des divers esprits qui s’affrontèrent ou s’allièrent dans l’aula conciliaire.
Ce bouleversement de l’espace sacré, et plus généralement la désacralisation de l’espace en général, est un phénomène post-chrétien. La perte des signes sacrés dans l’espace public a accompagné de près la perte des points de repère éthiques et métaphysiques, et le monde catholique n’a rien réussi d’autre ici, somme toute, que de suivre la pente commune et savonnée de la facilité, avec ce crâne parti pris pour le fait accompli à quoi tient tout le succès des révolutions. Son excuse est sans doute d’avoir voulu manifester par des changements sensationnels une réalité ecclésiale fraternelle et dynamique que la théologie jusque là était censée (voulait-on croire) avoir plus ou moins occultée, une réalité telle que tendait à l’exprimer selon le goût du jour le slogan désormais consacré, non sans un mimétisme plus ou moins inconscient par rapport à des utopies pourtant déjà bien en perte de vitesse, de « peuple de Dieu », régressant ainsi vers ce qu’a encore d’inaccompli (si l’on met à part la prophétie) une vision vétérotestamentaire de l’Alliance, et détournant ainsi l’intelligence chrétienne d’une vision de l’Eglise comme Corps mystique d’une part, comme Epouse et Mère d’autre part. En résumé, morne chute dans le sociologique, qui se traduisit dès lors un peu partout et pour longtemps dans une liturgie anémiée et boursouflée à la fois.
Une des marques les plus affligeantes de cette situation se trouve dans le dédoublement de l’autel, à savoir une table plus ou moins banale, évoquant dans plus d’un cas une table de conférences, un peu surélevée sur un prosaïque podium et placée devant et sous un maître-autel désaffecté réduit à servir de décor, inévitablement plus ou moins somptueux, sur lequel, comme signe involontaire mais combien éloquent du malheur des temps, n’est plus offert le saint Sacrifice , au profit de la notion réputée plus « porteuse » et plus adaptée de « repas » (ou de synaxe, le grec triomphant enfin du latin), mais d’un repas qui n’est à aucun moment présenté comme repas essentiellement sacrificiel – la réalité sacrale de repas, comme d’ailleurs celle de fête sacrée, étant de tout temps ce qu’on avait oublié ou n’avait jamais su, identique à celle de sacrifice –, mais très platement dans la perception obvie et profane d’un repas convivial, censément « festif », autrement dit gai et ennuyeux à souhait, où le mystère de la propitiation opérée par le Rédempteur chargé du péché du monde et rendant tout honneur et tout amour au Père ne pouvait, quoi qu’on en dise, que passer à l’arrière-plan.
Brûlait-on déjà à l’époque d’entrer de plain-pied dans la festolâtrie moderne sous prétexte de résurrection ? Quoi qu’il en soit, la résurrection elle-même n’évita qu’à grand’peine d’être aplatie au niveau d’un bien-être socio-psychologique, au ras des pissenlits et volontiers pacifiste. Pacifiste, à moins d’opter pour quelque folklorique guévarisme, pour l’un ou l’autre crypto-trotskisme qui ne coûtait rien à des Occidentaux repus, résolument partis pour la gloire consumériste (car les « trente glorieuses » doivent être exactement appelées, comme on a pu le dire, « les trente honteuses parties pour la gloire et s’achevant en flop »), à l’heure même où nos frères chrétiens, nos frères humains, croupissaient dans les camps et geôles brejnéviens, maoïstes, polpotiens, pour ne citer que les plus illustres. Et, chose non moins digne d’étonnement, tandis que se prêchait un christianisme de ressuscités de rigueur qui n’encourussent plus le célèbre reproche de Nietzsche au sujet des têtes d’enterrement, dans le même temps, tout en noyant avec la plus grande désinvolture la question des fins dernières, on se mit purement et simplement à révoquer en doute le fait de la résurrection, sous l’influence tardive d’une lecture mal digérée de R. Bultmann, des prophètes de la mort de Dieu et qui sais-je encore.
Certes, beaucoup d’eau a passé sous les ponts du Tibre et sous ceux de la Moscova, mais qui croira sans plus de preuves que cette confection élevée témérairement au rang de rite, et de rite universel, imposée autoritairement, qui, soit en pure légalité soit dans une exécution plus royaliste que le roi, fut à point nommé le vecteur des errements susdits, pourra un jour être dégagée par d’improbables doigts de fée du nœud compact dont elle est solidaire, et, avec de si suspectes origines, donner lieu à une postérité viable ?
Il a été question plus haut de la notion qui a pu fournir à une perte de sens eucharistique sa justification théorique, justification dont le mirage ne résiste pas à une définition des termes. Une liturgie ne saurait, en effet, ni en rigueur ni en vigueur de termes, être appelée « de la parole », pour la simple raison que toute liturgie est une parole en acte, une action, accompagnée de paroles, certes, mais des paroles qui ne commentent pas mais opèrent, performatives, comme disent les linguistes. L’idée même de s’asseoir pour écouter des discours ou des lectures est profondément anti-liturgique. Ce n’est pas qu’on ne puisse user de bancs par nécessité, mais seul le siège épiscopal peut avoir une légitimité liturgique et donc, il va sans dire, ecclésiologique. C’est si vrai, que, par exemple, dans le rite byzantin, le prêtre célébrant laisse toujours inoccupé ce siège (équivalent de la « cathèdre ») réservé à l’ordinaire de l’éparchie (du diocèse) s’il est présent, ou éventuellement à l’un de ses pairs (ce qui se comprend sans peine quand on sait que tout évêque est évêque pour toute l’Eglise). Idéalement, il n’y a que l’évêque (ou le père Abbé) qui puisse, de manière rituellement acceptable, s’asseoir à certains moments précis. Que penser alors de l’idée d’un célébrant défini comme « président » de la « synaxe » ? Président veut dire s’asseyant en premier. Le prêtre n’est pas un notable assis, mais un pasteur debout qui se tient en tête de son assemblée, dont il est le serviteur, se tournant avec elle vers Dieu. Et que penser, de surcroît, de cet hybride, ni clerc ni tout à fait laïc, l’« animateur » qui, en rapport de forces tendu (et même distendu) avec le « président » susnommé, de la place la plus en évidence, armé de l’outil qui confère le seul pouvoir sérieux, le micro, confisque le regard des fidèles sous le prétexte ingénu de leur montrer (à eux, mais aussi au prêtre le cas échéant) ce qu’ils ont à faire, à dire, à chanter, à penser, comme s’ils étaient le public occasionnel d’un show, d’un meeting, dans lequel l’important est d’être suffisamment « chauffé » pour bien « participer » (a‑t-on fait assez tourner le manège des innovations autour du slogan parfaitement vague et d’autant plus impérialiste de participation!), ou comme si ces fidèles, ce Peuple saint, n’étaient tous encore, telle une masse à pétrir comme le public entassé pour assurer la claque autour des jeux qu’on montre à la télévision, que des catéchumènes de la première minute, inconscients de leur éminente dignité, ignorant ce qu’ils ont à faire face à ce « président de synaxe » qui les « interpelle », condamnés à rester des non initiés perpétuels jusqu’à l’heure de leurs funérailles (que des laïcs complaisants leur assureront en l’absence probable de ministre ordonné)?
De même que, en soi, il n’y a pas de chaises, une tribune, pour une liturgie qui se respecte, ne se conçoit pas davantage. Si jadis, au temps des jubés, le lecteur (ordonné) se plaçait à l’ ambon, c’était pour, à son rang, être pontife, assurer le pont de la nef au chœur, entre lesquels il n’y a pas cloisonnement mais passage. Dans les églises byzantines, le lecteur lit l’épître depuis la nef et tourné vers le sanctuaire (délimité par l’iconostase), le peuple restant debout, car il est « en marche » (idée à laquelle aucun fervent de Vatican II ne sera insensible, que je sache). Notons aussi qu’il n’est pas question pour le lecteur, ni pour le diacre ou le prêtre lisant l’évangile, de lever les yeux du lectionnaire, contrairement à cette habitude que l’on a cru devoir prendre de tenir le public en haleine et qui a pour résultat de focaliser l’attention sur le talent théâtral plus ou moins exercé du lecteur (non ordonné), au lieu que, rivé au livre sacré, il s’efface entièrement par rapport à lui, usant d’une lecture cantilée qui apporte la nécessaire amplification poétique et, tout pratiquement, acoustique (ce qui a longtemps épargné au culte l’obscène « sono » qui a fini absurdement par en devenir le fer de lance).
Enfin, rappelions-nous, une liturgie constitue un tout indivisible et ne saurait donc être découpée en parties se déclinant comme suit : pénitentielle, de la louange, de la parole, de l’offertoire, de la préface, de la consécration, de l’intercession, de la communion, de l’envoi – toutes phases qui en fait se compénètrent sans clivages du début jusqu’à la fin –, aux dépens de son unique mouvement dramatique, dont le sommet est la consécration, et dans l’éclosion puis l’épanouissement duquel l’assemblée et le clergé s’encouragent mutuellement à suivre l’Agneau jusqu’au moment, l’ayant reçu en nourriture en tant que Pain vivant, d’être en réalité assimilés à lui afin de constituer sa présence substantielle dans le monde. Chaque intervention, exhibition, injonction, freinage qui vient interrompre ou relâcher cet élan tout uni et tout unifiant casse la signification du culte, sans parler de l’épuisement pour les têtes et de la frustration pour les cœurs – et de la torture pour l’oreille –, car le didactisme assez moralisateur qui caractérise nos « liturgies de la parole » (débordant volontiers leurs rives en de désastreuses inondations) transforme en corvée, en surmenage, ce qui devrait être alacritas, allégresse, dans une contemplation simple du mystère de la foi, dans une écoute recueillie d’un langage et d’une musique tous deux issus du silence et retournant s’y fondre, dans un chant qui s’élève sans discordance et sans recherche d’effets à quatre sous, dans une digne et fervente communion des uns avec les autres sous l’onction de l’Esprit de Jésus.
Beaucoup se félicitent, pour son effet catéchisateur, de cette mise à l’honneur de ce qu’ils appellent « la parole », témoignant souvent de leur absence de crainte révérentielle aux yeux de tout croyant sachant Qui est la Parole. Eh ! bien, qu’est-ce qui empêcherait de procurer cet effet incontestablement bénéfique en ses lieu et place ? La messe, qui, en elle-même, est catéchèse vivante, a une tout autre fonction, celle d’être le cœur du temps placé dans l’éternité. Tout se passe comme si on voulait qu’elle serve à tout, pourvu que ce soit le plus brièvement possible et au moindre coût.
En parlant de coût, la quête elle-même est liturgie, preuve que les rites ne sont pas déconnectés du quotidien tel qu’il est, et c’est ici par une gestuelle de partage et d’aumône. Encore faut-il songer à entreposer billets et pièces de monnaie, qui, en tant que tels, ne sont pas récupérables dans l’univers sacré, loin du saint des saints, les déposant au fond de la nef, à défaut de narthex, comme l’ont toujours fait d’instinct les rites chrétiens tant qu’ils n’étaient pas dénaturés par la réflexion et les bonnes intentions.
Le présent cahier des charges fermé, ce sera pour le moins faire preuve d’une saine sensibilité liturgique que de se garder de siéger à la place, non plus seulement de l’évêque, mais de Dieu, seul juge des fruits que les prêtres ont pu donner, et donnent encore, en ces temps troublés ! Beaucoup d’entre eux ont « fait avec » ce qu’on leur octroyait et sous la contrainte sourcilleuse d’une surveillance fréquemment vexatoire, trait récurrent de tout libéralisme comme de tout cléricalisme, cléricalisme laïque inclus.
L’insatisfaction où ne peuvent que laisser le peuple chrétien les solutions qu’on lui vante aujourd’hui (par exemple, une « réforme de la réforme », qui ne saurait donner qu’un rapiéçage du rapiéçage), aussi louable que soit l’esprit de modération qui les inspire, tient à ce qu’elles omettent, finalement, l’enjeu principal de cette question rituelle. Ne risque-t-on pas en effet de se résigner à la dégradation de la culture (civilisation), à la technicisation et à la mise aux normes de l’existence humaine avec des conséquences éthiques aussi implacables qu’incalculables, à la dépoétisation totalitaire du monde (le mot de poésie devant s’entendre ici avec sa portée métaphysique et spirituelle), à l’extermination, en tout cas à la brimade, de l’esprit d’amour et de vérité jusque dans son sanctuaire et sa citadelle : le culte ? On ne jette pas en pâture à des tournois d’érudition ou de monomanies intellectuelles, à des marchandages, à des mesures arbitraires, dans le cadre de « commissions » et de « conférences » (fussent-elles épiscopales), l’œuvre organique du Saint-Esprit, seul Auteur de toute vraie tradition et inspirateur du plus humble fidèle autant que du clerc le plus savant.
Au fait, qui s’intéresse encore à la liturgie autrement que comme terrain d’affrontement ou d’expérimentation, esthétique ou autre ? Et comment expliquer le mutisme dont firent preuve à son propos ceux qui étaient tout désignés pour être ses penseurs les plus féconds ? Pour ne nommer que l’un d’entre eux, mais non le moindre, n’est-il pas déroutant que ce chantre de la beauté de la Création et de la Rédemption, celui de l’organicité de la Révélation, de l’unité rayonnante du mystère chrétien, se soit si peu prononcé, à ma connaissance, je ne dis pas en faveur du retour à une décence rituelle (ce qu’il a fait), mais sur la force d’attrait dont un culte digne de la plus grande religion de l’histoire, le catholicisme romain, se montrerait doté pour peu qu’on s’avise de son effet sur tous les domaines de l’existence, et qui déborde infiniment le cadre d’une question de « sensibilité religieuse », de goûts et de couleurs, de triomphalisme ou de « pauvreté » (souvent fort coûteuse, on le sait, en mises en œuvre)? Je veux parler du grand Hans Urs von Balthasar, dont l’influence est connue par rapport aux positions de Rome, en tout cas depuis Jean-Paul II. Doit-on admettre que la flamme qu’un de ses maîtres, Romano Guardini, avait cherché à transmettre se soit étouffée, peut-être par découragement, tant devant les victoires planétaires de la sottise pontifiante et de la vulgarité légiférante, que sous les rafistolages assez piteux dont un clergé doutant de lui-même, si ce n’est au contraire imbu d’une sûreté présomptueuse, et muni de justificatifs venant de haut, a fait, pour la bonne cause, hélas ! le produit de ses pratiques compensatrices de propagande et de marketing ? Ou s’agit-il d’une influence souterraine irrésistible de la pensée du pasteur Dietrich Bonhöffer, pensée conditionnée par un contexte historique particulièrement tragique mais complètement dépassé, au premier et peut-être aussi, craignons-le, au second sens du mot – en proportions, en profondeur et en nocivité ?
A cet égard, la position d’une Catherine Pickstock, théologienne anglicane de Cambridge, me paraît combien mieux faire droit à l’essence d’un débat qui n’est d’abord ni intellectuel, ni artistique, ni cultuel, mais vital au sens naturel comme surnaturel, et que pourrait résumer l’interrogation que voici : l’humanité saura-t-elle se retrouver elle-même, choisira-t-elle, à tout le moins de la part des meilleurs de ses membres, d’accomplir sa destinée ? Prendra-t-elle à nouveau le Rite comme fondement de la pensée et de l’action ?