La royauté du Christ, genèse d’un déclassement
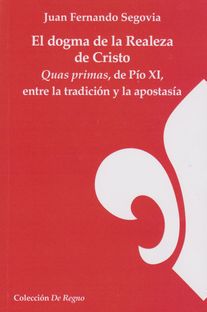 Sur le dernier ouvrage de Juan Fernando Segovia.
Sur le dernier ouvrage de Juan Fernando Segovia.
L’auteur, déjà connu de nos lecteurs, a malheureusement quitté ce monde au cours de ce mois de mai 2025. Le présent texte[1] est l’un de ses derniers travaux, offrant la synthèse d’une série de contributions à des publications collectives sur le dogme de la royauté du Christ, spirituelle et temporelle indissociablement. Il commence par une définition de la royauté sociale du Christ, centrée sur l’encyclique de Pie XI, Quas Primas, dont on célèbre le centenaire cette année. Puis il mène une analyse des principales négations de ce concept, logiques dans l’esprit du protestantisme et du libéralisme, moins logiques mais tout aussi intelligibles dans les tentatives successives d’accepter l’état de fait au sein de l’Église, moins logiques encore dans certains milieux où l’on ne l’attendrait pas, en l’occurrence les quelques groupes de catholiques adeptes du « spirituel d’abord » s’affairant à camper ensemble loin des affaires du monde, donnant ainsi forme à un « communautarisme catholique » – ou son pendant clérical, une « hiérocratie ». Vient enfin une analyse des effets de la crise liée à Vatican II, le principal étant de vider de sens le dogme de la royauté du Christ exalté il y a maintenant un siècle.
F. Segovia place au point de départ de la privatisation de la foi la conception luthérienne de l’Église, pure association libre de fidèles et non pas société instituée divinement par le Christ qui en est la tête et dont tous les hommes sont appelés à être les membres. Il retient cinq séparations : entre la nature et la grâce, entre celle-ci et les sacrements – tenus pour symboles et non pour signes efficaces de la grâce –, entre la foi et les œuvres ; et pour achever, la séparation entre la foi et la raison, enfin entre les églises – dénomination factuelle des ensembles réunissant des croyants, non l’Église institution divine – et la puissance politique (l’État). Il y a donc bien pour Luther un Christ-Roi, cependant « sa royauté n’est pas de la terre ni sur le terrestre, mais il est roi de biens spirituels comme la vérité, la sagesse, la paix, la béatitude, etc. » La suite va de soi, essentiellement ramenée à la subjectivité du sentiment religieux. Dans le meilleur des cas, le plus abstrait aussi de la réalité, la formule proposée par Habermas résume l’idéal commun d’une démocratie laïque apaisée : agnosticisme public, confession religieuse privatisée. L’origine, clairement luthérienne, de cette distinction fallacieuse réside dans la dépréciation des œuvres, au premier rang desquelles la politique ; c’est ce que J.F. Segovia nomme « l’apostasie de la royauté partielle », comme si certains secteurs de la réalité, ou certains actes pouvaient être soustraits à la souveraineté divine, mais pas certains autres.
La dernière partie de ce dense petit volume aborde les mentalités répandues dans l’Église contemporaine, celle, par exemple, qui considère que la royauté est passée de mode, tout comme le fut le port de la soutane, qu’il vaudrait mieux parler de l’utopie de Dieu, la « royauté » du Christ restant seulement en tant qu’image d’une présence aimante dans le cœur des croyants…
À l’arrière-plan de toutes ces déviations, ce n’est pas d’abord la négation des droits de Dieu qui est en cause, mais plutôt celle de la nature, tout entière soumise à son Créateur et Rédempteur, et domaine essentiel du vouloir humain qui, comme tel, exerce par elle et sur elle un sacerdoce authentique.
[1] El dogma de la Realeza de Cristo. Quas primas, de Pío XI, entre la tradición y la apostasía, Consejo de Estudios hispánicos Felipe II, coll. « De Regno », Madrid, février 2025, 100 p., 15 €







